
 |
||||||
accueil |
billet |
philosophie |
sciences |
culture |
lectures |
liens |
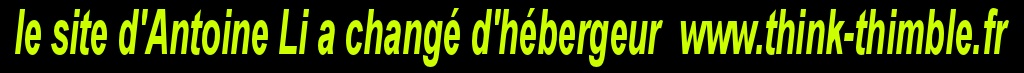 |
|||||
ValeurLe mot de valeur est au départ un terme très général. Etymologiquement, il est rattaché aux notions de force, de santé, de puissance, d’utilité, et de mérite. Mais un des problèmes contemporains dans l’emploi de ce mot est son absorption par la sphère économique, et sa dérive vers la notion plus restreinte de prix (qui est ce contre quoi on échange). Une confusion mentale tend alors à s’instaurer entre valeur au sens moral (celle qui n’attend pas le nombre des années) et valeur au sens économique (la valeur marchande). Cette confusion est problématique car en toute rigueur, on devrait distinguer pour un objet une valeur intrinsèque (lorsque les fins sont inhérentes à l'objet considéré), d'une valeur instrumentale (lorsque les fins sont extérieures à l'objet). On doit aussi souligner que la valeur n'est pas une chose en soi, mais qu'elle est produite par un évaluateur, avec un lien plus ou moins direct à une des formes de son bonheur. Une fourmi n'a manifestement pas la même valeur pour un homme, un tamanoir ou un puceron. Tout cela devrait inciter à une très grande circonspection dans la comparaison des valeurs. Pour tenter malgré ces difficultés de comparer les valeurs, la pensée économique a cherché à quantifier "la" valeur (incluant éventuellement la valeur au sens moral), en ayant recours à quelques subterfuges qui sont à la source de nombreux abus de langage. En effet, pour objectiver et rendre manipulable la valeur, la théorie économique a introduit la notion d'utilité, privilégiant de ce fait la valeur instrumentale, principalement sous sa forme monétaire qui est la plus polyvalente. Au XVIIIe siècle, quand naissent les théories économiques, des philosophes pensent qu'il est plus raisonnable de gouverner par l'intérêt plutôt que par les passions. L'idée de remplacer les valeurs morales (amour, bonheur, honneur, ) par l'utilité permet de régler par l'argent bien des conflits et de pacifier des sociétés où on s'est beaucoup entretué au nom de valeurs suprêmes. La valeur monétaire n'a cependant pris le dessus sur les valeurs morales que progressivement, jusqu'à conduire au cynisme économique contemporain pour qui la fortune est pratiquement devenue un indicateur de vertu. En outre la théorie économique a cru possible de réduire la part de subjectivité attachée à l'évaluateur en affirmant que la valeur émerge lors les échanges entre acteurs. C'est la raison de l'imporance fondamentale conférée au marché dans la pensée économique, et aujourd'hui politique. Ainsi construite, cette valeur économique est sans doute quantifiable, et elle se prête plus souplement à toutes sortes de raisonnements, calculs et manipulations, mais elle a alors tendance à prendre le pas sur la valeur morale qui est imprécise, générale, indéfinie. Quand on dit que la vie n’a pas de prix, on met en évidence cette différence fondamentale, mais le recours permanent à ce mot plus ambigu de valeur montre que pour certains il semble possible de donner un prix à tout. Cela a commencé avec les utilitaristes, et c’est loin d’être fini. Nous résolvons tous les problèmes par l’argent, les assurances sont omniprésentes et gèrent des accumulations colossales qui démontrent notre envie nous prémunir contre le malheur par des compensations financières. Un économiste de Chicago a même eu récemment un grand succès en proposant d’interpréter toutes sortes de comportements sociaux (y compris crime et prostitution) en termes de choix économiques implicites. En toute rigueur, la valeur économique n’a pas autant de sens qu’on le croit : Même pour les économistes, il y a des divergences entre valeur d’usage, valeur marchande, valeur spéculative, valeur de remplacement, etc…Cette notion reste cependant commode car la quantification apparente permet dans les conflits (pas seulement marchands) de rendre des arbitrages, dont la rigueur de processus masque la fragilité des prémisses. Heureusement, les économistes pensent avoir trouvé dans l’institution du marché une machine capable en principe de résoudre ces divergences. On peut donc apparemment tout compter, et il est notable que la question écologique doive une partie de ses progrès au rapport Stern qui quantifie et met en regard « le coût » de la lutte contre le réchauffement climatique avec « le coût » de ses effets supputés. Une telle présentation parle directement aux décisionnaires. Pourtant, l'économiste André Orléan montre bien comment cette notion de valeur dont l'existence objective est au fondement des théories économiques est en réalité un mythe. L'observation des comportements réels dans les échanges contredit très largement les hypothèses à partir desquelles la théorie économique prédit des marchés autorégulateurs capables de faire apparaître la "vraie" valeur des choses. Le mimétisme des acteurs peut tout autant conduire à ces folies spéculatives qui rendent le monde financier si instable et si absurde. Pourquoi le monde actuel s'organise-t-il comme si tout se réduisait à une affaire d’argent, comme si tout pouvait s’acheter ? le bonheur, la beauté, la rareté, le savoir, l’amour, la sécurité, le pouvoir, l’honneur ? Cette société de consommation qui essaie de le faire croire est en contradiction manifeste avec la plupart des sagesses séculaires de l’humanité. Même si l’argent est souvent un facilitateur, les vertus ne sont évidemment pas une question de prix . Pour combattre cette prétention du monde marchand, on invoque en général « les valeurs », ces fondements de la morale, partagés ou non, qui en principe servent de référence dans l’action et le jugement. Comme pour d’autres notions, on peut distinguer le cas de l’individu (d’un intérêt relatif) et celui du groupe ou de la société (plus en rapport avec les questions qui se posent à l’humanité mondialisée). On peut aussi essayer de voir les valeurs explicites (celles qui s’affichent dans les devises nationales et les slogans politiques) et les valeurs implicites qu’on peut analyser à partir des faits sociaux ou chercher à traquer dans les sondages. Quelles seraient aujourd’hui les valeurs qui gouvernent les sociétés contemporaines ? Si on regarde les mythes propagés par la publicité et les médias populaires, tels que le cinéma ou même les jeux vidéos, on pourrait dire en vrac : argent, force dominatrice, performance physique, célébrité, plaisir immédiat, pouvoirs magiques et toutes sortes de rêves puérils…Un tel constat devrait nous rendre inquiets. Quelle devrait être la hiérarchie des valeurs pour un monde humaniste du vingt-et-unième siècle ? C’est une question très riche qui n’est pas entièrement nouvelle et pour laquelle les sagesses anciennes ont gardé une part de pertinence. Elle se complique de données nouvelles pour lesquelles nous manquons de repères et qui nécessitent un renouvellement philosophique. Un des problèmes urgents de l’humanité est à l’évidence de sortir de la confusion de sens, de rétablir une frontière entre les valeurs morales et la valeur économique. Il est aujourd'hui important de relativiser fortement une valeur telle que la richesse (au sens monétaire) qui tend à dominer dans les décisions des puissants (parce qu’on assimile la valeur économique à une monnaie unique universelle de tous les bonheurs), et de réhabiliter les valeurs de la Nature, qu’on a trop sacrifiées aux intérêts marchands. Cette Nature, dans sa complexité, est unique, donc rare, pas toujours mais souvent belle, et elle est le fruit d’un travail extrêmement long et patient de l’histoire planétaire. Lui attribuer un prix, quel qu’il soit, et même si cet artifice peut parfois être utile, c’est la rabaisser. La philosophe Virginie Maris explique ainsi que défendre la Nature (la biodiversité) en fonction de ses services recèle un piège : en introduisant l’idée que la protection de la nature devrait résulter des services qu’elle rend, et non du fait que nous en faisons partie et que nous en sommes dépendants, on nie implicitement toute valeur à ce que la nature peut avoir d’inutile. On ouvre aussi à son appropriation marchande. La Nature est, au sens littéral, inestimable. Think-thimble http://antoine.li.free.fr |
 |
||||
Mots associésEconomie Affaires IntérêtMarché, marchandise Rationalité, Logique Science Complexité Echelles, mesure Bonheur Sagesse Pensée, volonté collectives Le bien, le mal, la morale vers liste alphabétique |
|||||
Liste des mots clésUnivers Planète Nature - vie Emergence EvolutionHomme Pensée Volonté et liberté Pensée, volonté collectives Individu - société Le bien, le mal, la morale Buts, finalités Bonheur Sagesse Harmonie, beauté Parfait Ennui Rationalité, Logique Science Complexité Analogie Métaphysique Dieu, religion Hasard Futur Progrès Modernité Nomadisme Utopie Extraterrestres Développement Progrès technique Energie Force, puissance Economie Affaires Intérêt Marché, marchandise Valeur Croissance Dette Compétition Performance Décomplexé Hédonisme Récupération Démocratisation Populisme Domestication, troupeau Aliénation Peur, précaution Confiance, optimisme Pragmatisme Opportunité Limites, illimité Barrières, cloisons Echelles, mesure Horizons Mécanique Vitesse, lenteur Frottements, freins Slip - stick Effet transistor Météorologie Immobilisme, changement Banc de poissons Mayonnaise Surimi Préfixes Suffixes Oxymores Durable Renouvelable Ecologie Ecologiste Empreinte écologique Décroissance Cycle Diversité Artifice Racines Jardin Produit Usine à gaz Déchets Sobriété Santé Drogue, addiction Obésité Crise Vérité, doute, certitude Tous dans le même bateau? Penser, agir au XXIe siècle  |
|||||
auteur
|
|
haut de la page
|
retour à l'accueil
|
billets anciens
|
ancien site
|