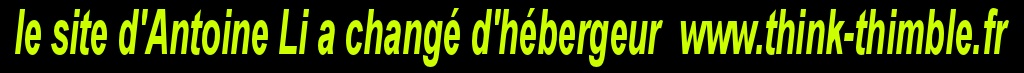Science
La
science (il vaudrait mieux dire les sciences) est un des aspects de la
rencontre entre le monde réel et l’esprit
humain.
Elle a pu se
constituer parce que ce monde réel fonctionne selon des lois, dont une
partie a pu être intégrée par notre entendement.
On n'oubliera pas que la
science est
une création éminemment collective,
accumulée par les
hommes au cours de plusieurs siècles de curiosité critique. Que la
compréhension
des hommes
ait pu atteindre ce degré d’élaboration, avec toutes les
conséquences que cela implique quant à la position particulière de
l’homme sur la Terre, et notamment son pouvoir d’agir et sa
responsabilité, est un sujet inépuisable d’étonnement, mais en tout
cas, c’est un fait incontestable.
La
science est une grande entreprise de construction de la vérité.
Elle se propose de mettre en évidence et de caractériser les causalités
et les régularités qu'elle relève dans ses objets d'étude. C'est
pourquoi elle énonce des lois, elle mesure et révèle les mathématiques
ou tout au moins les logiques de ce qu'elle observe. La méthode
scientifique, telle que fondée par Bacon, puis Descartes et plus
récemment Popper repose
sur la raison,
la vérification
par la
confrontation au réel, et la place laissée au doute vu comme une
marge de perfectionnement.
Car la connaissance scientifique se considère toujours par principe
comme imparfaite, l'objectif de vérité étant en fait un idéal toujours
repoussé par l'infini du questionnement.
Il faut aussi souligner que si la science cherche à satisfaire une
grande part de la curiosité de hommes, elle laisse aussi certaines
questions hors de son domaine. Quoiqu'on le dise assez couramment, la
question des buts et des fins
ne fait pas
partie des objectifs de la science.
Descartes, un des fondateurs de la méthode scientifique rappelait "qu'il
ne faut point examiner pour quelle fin Dieu a fait chaque chose, mais
seulement par quel moyen il a voulu qu'elle fût produite" et de ce fait, "il rejetait entièrement de sa
philosophie la recherche des causes finales".
Même si la science de cette époque a pu parfois poursuivre des buts
théologiques en donnant à admirer l'ordre de la Nature, son postulat
fondamental était de s'en tenir à l'objectivité des observations, en
mettant à l'écart la question des buts éventuels. Croyant ou non, le
scientifique ne s'occupe que de faire
avancer le savoir, non la croyance.
C'est pourquoi la théorie de l'évolution de Darwin est si dérangeante
pour ceux qui veulent voir dans l'existence de l'homme un des buts de
la création (et même du Créateur).
A ce principe d'objectivité, la
science ajoute aussi un principe de
parcimonie, c'est-à-dire que les explications ou les descriptions
qu'elle propose doivent tendre vers la simplicité. Permanences causales
et description d'une logique des choses, lois mathématiques,
universalité des principes fondamentaux s'inscrivent dans cette
tendance. Pour le physicien Ernst Mach, la
science vise à présenter, selon la moindre dépense intellectuelle, un
maximum d'explications des phénomènes en un minimum de propositions.
Henri Poincaré souligne le rôle
primordial de l'astronomie dans cette
démarche: en décryptant les mathématiques du mouvement des astres et en
permettant de prédire leur position, elle nous a appris à croire au
principe d'un ordre du monde et à nous défier des apparences premières.
L'attraction universelle établie par Newton permet de décrire de façon
extraordinairement simple une multitude de phénomènes, chute des corps,
mouvement dans le système solaire, elle a permis de prédire l'existence
de Neptune, puis de Pluton, on l'utilise dans la détection des
exoplanètes et elle est une composante majeure du mouvement des
galaxies. Prolongeant ce moment majeur, les physiciens sont partis à la
recherche de l'unité du monde, car ils restent plus que jamais
convaincus que leur science progresse par des lois d'unification. On
peut dire que les sciences de la vie suivent ce chemin au fur et à
mesure que progressent les méthodes pour appréhender la complexité des
objets étudiés.
Ainsi, c'est par sa rigueur
dans l'interprétation d'observations méthodiques que la science a pu se
montrer si extraordinairement utile,
mais l’appréhension scientifique repose toujours sur une idéalisation des
réalités, et souffre par là d’une part irréductible
d’incertitude,
voire de fausseté. Plus les questions qu'on traite sont complexes,
plus cette
incertitude reste importante.
C’est de là que vient l’imprécision des
sciences du vivant, et encore plus des sciences humaines et sociales.
En effet, avant de décrire le monde par des lois ou des principes qui
sont
la base des prédictions, la démarche scientifique doit rendre les
observations aussi rigoureuses, précises et objectives que possible.
L'instrument d'observation ou l'appareil de mesure permet aux multiples
observateurs d'unifier leur perception des phénomènes. Lire une
indication sur une graduation, regarder dans une optique grossissante,
décrypter l'image produite par un appareil augmente et rend plus
objective notre capacité perceptive et sensorielle. Ce qui est
techniquement faisable dans les sciences de la matière devient déjà
plus difficile dans le monde du vivant. A fortiori, le scientifique se
heurte à des problèmes de méthode parfois insolubles lorsqu'il veut
appliquer la même rigueur à la description des phénomènes sociaux.
L’économie par exemple, a
choisi
de privilégier la rigueur mathématique en ne mesurant que des
phénomènes de valeur. Elle se veut ainsi une physique des valeurs,
mais elle est en fait une façon
très filtrée d’envisager les sociétés humaines, et reste donc chargée
d’un grand degré d’approximation. Il faudrait donc remettre à leur
juste place les jugements qu'elle porte sur la marche des sociétés,
mais à cause du pouvoir pris par l'argent, notre époque est fortement
marquée par ce regard très partiel et donc très déformant sur la
société, qu’on désigne sous le nom d'économisme.
Les
succès concrets obtenus à
partir de certaines sciences (notamment des sciences dures) ont suscité
une confiance
parfois excessive dans la méthode scientifique. On a
construit des théories autour d'objets très incertains, avec une forte
tendance à en oublier les imperfections, les imprécisions ou le
caractère parfois très spéculatif.
La philosophie du dix-neuvième siècle, avec
notamment le Positivisme, est souvent sujette à cet espoir excessif
placé dans la science. Comme le dit Axel Kahn, la science n'est pas la
vérité, c'est la recherche de la vérité. Aujourd'hui
encore, certains milieux sont
sujets
au scientisme, une confiance excessive dans la science, oublieuse des
méfaits engendrés par un enthousiasme prématuré ou une pratique à
l'éthique mal mesurée. Car comme
l'explique Hans Jonas, l'accroissement
considérable de notre puissance d'action devrait logiquement entraîner
une augmentation proportionnelle de notre responsabilité, de notre
vigilance et de notre prudence.
En effet, la
science à la recherche d'une
reconnaissance sociale
(pour son crédit ou pour ses crédits) s'est souvent montrée assez
vantarde, promettant des miracles
et minimisant les risques.
Lorsque les miracles ne sont pas au rendez-vous ou lorsque les dangers
apparaissent, une méfiance accrue s'instaure, pour ne pas dire une
certaine paranoïa. L'absence
de recul éthique de certaines
recherches, le pouvoir dominant pris par la vision scientifique, la
complexité et l'obscurité de certaines expertises, expliquent cette
défiance de la part d'un public qui se sent écarté de décisions qui le
concernent pourtant au premier chef. Ce n'est pas en assimilant
cette attitude à l'obscurantisme (ce qui revient à assimiler science et
progrès) qu'on apaisera le conflit. A l'inverse,
il faut arriver à
faire exister le débat, en éclairant autant que possible la société par
une bonne vulgarisation.
En accroissant leur complexité
et leur spécialisation, les
sciences ont gagné en puissance mais elles se sont coupées du grand
public.
L'institution scientifique elle-même ne cherche pas à être
démocratique, mais à faire émerger une connaissance rationnelle et
correctement construite en entretenant des débats contradictoires où
les idées sont soumises non au vote, mais à l'examen contrôlé de la
communauté. Les membres des institutions scientifiques sont cooptés en
fonction de titres et de publications plus souvent qu'élus selon des
procédures représentatives. Au
niveau de la société, les décisions
collectives sur les recherches et les techniques sont tributaires de
discussions d'experts qui supplantent les débats citoyens. Les
médias, courtisés par les lobbys en présence et alimentés en
informations spectaculaires ou abusivement simplifiées ne contribuent
pas vraiment au rapprochement des points de vue, et lorsque les choix
des acteurs de la science engagent trop fortement la société tout
entière, un tel décalage n'est plus acceptable. L'incompréhension, la
défiance peuvent tourner à la paranoïa, comme dans les débats sur les
nanotechnologies par exemple. Des tentatives louables sont faites pour
trouver des modalités pour éclairer le grand public, confronter les
points de vue et pour faire émerger des décisions socialement
acceptables, tant par les spécialistes que par la société dans son
ensemble. Il faudra cependant du temps avant qu'on échappe à la logique
d'influence des lobbys qui préside aux décisions actuelles.
Dans ces débats, on entend
souvent les scientifiques confrontés aux
mauvaises applications de leurs découvertes protester que la
science
serait par essence neutre, que ce
sont les applications qu'on en fait
qui sont condamnables, que toute curiosité scientifique est
bonne à priori, même si les découvertes de la science ne sont pas
à mettre entre toutes les mains. A mon avis, c'est là une façon un peu
rapide d'exonérer les scientifiques de leur responsabilité.
Ils appartiennent à la société
comme tous les hommes et revendiquent
même souvent un respect supérieur dû selon eux à la valeur de ce qu'ils
contribuent à produire. Je
ne
crois pas que toute recherche respectant
les canons de la science soit par essence bonne, ou même neutre. La curiosité,
fût-elle scientifique ne
dispense pas de toute prudence, et ceux qui choisissent les
sujets
de
recherche devraient être les premiers à réfléchir aux enjeux (positifs
ou négatifs) d'une
future découverte. Le
chercheur en quête de crédits n'hésite pas à faire miroiter des
applications mirifiques souvent présentées de façon excessivement
optimiste. Mais à bien y regarder, il n'est pas évident que le tableau
des recherches en cours soit toujours si clairement orienté vers le
bien. La science n'échappe pas à l'influence de la sphère
économique ou
politique. L'histoire
des sciences montre bien comment l'esprit de
lucre, l'appétit de puissance militaire (et il faut le dire aussi
l'amusement des élites) ont été des moteurs
constants dans le
développement des sciences. Elle montre aussi de
multiples
exemples de
dévoiement moral non seulement des recherches ou des théories, mais
aussi des scientifiques eux-mêmes. L'eugénisme restera longtemps
une
page sombre de la biologie. Les progrès de
la chimie
ou de la physique nucléaire dans le contexte des guerres mondiales
ont eu des
conséquences dramatiques qui ont jeté d'énormes doutes sur la valeur
morale du progrès scientifique et technique. Certains des scientifiques
à
l'origine de ces "progrès" ont fait état de leurs remords. Depuis cette
époque, il est
devenu évident que les progrès scientifiques ne
coïncident pas toujours avec le progrès moral et humain.
Aujourd'hui, l'activité scientifique surdéveloppée est encore plus que
jamais dépendante des enjeux économiques, et elle participe plus
que
jamais à l'entreprise généralisée d'exploitation marchande de la
biosphère. A côté de cette recherche dominante à but
lucratif (à plus
ou moins long terme), il
est essentiel d'entretenir une recherche
capable de mettre en évidence les effets de cette exploitation, sur
la
nature ou sur la santé des êtres vivants. Cette recherche
indépendante des intérêts économiques doit être assez
active (et donc bien
dotée) pour produire et diffuser
une connaissance capable de corriger les
présentations biaisées
par l'intérêt.
Il faut
s'inquiéter de cette tendance actuelle au
désinvestissement de la puissance publique en
faveur du financement privé de la science dans la plupart des
domaines, et n'envisager qu'avec la
plus grande circonspection le
recours au
mécénat même s'il se proclame désintéressé. Il faut aussi dénoncer les
nombreux conflits d'intérêt provenant de cette consanguinité générale
entre industrie et recherche (comme par exemple ces
études toxicologiques faites par les promoteurs des agropesticides) et
promouvoir la création et le financement public d'organismes ayant pour
mission la défense de l'intérêt public.
Il serait
également important
que les futurs chercheurs soient confrontés à toutes ces questions
d'éthique relatives à la science dans
le cours de leurs études et puissent y réfléchir sérieusement avant que
les intérêts professionnels ne biaisent leur jugement.
La science, si
pertinente
soit-elle, n’est pour autant pas le
seul mode valable d’appréhension du monde. En tant qu’êtres
biologiques
complexes, nous
restons tributaires de la perception sensitive, et
donc
de l’approche sensible et émotionnelle.
Ainsi, on a énormément de mal à donner de la douleur une mesure
objective, et personne ne se risque à mesurer la beauté ou les vertus
morales. Par ailleurs, en tant
qu’héritiers d’une longue histoire des civilisations, notre langage et
notre culture sont imprégnés des conceptions anciennes, religieuses et
philosophiques notamment.
Il faut cependant admettre que l'extension des
connaissances
scientifiques a rendu caduques bien des réponses proposées autrefois
par les religions ou la philosophie
(notamment la métaphysique).
Pour
autant, la
science n'a pas épuisé les grandes
questions sur lesquelles
se sont penchées des générations de philosophes. Elle a réorienté ces
questions ou leur en a substitué d'autres.
Mais si peu à peu, l’ensemble
des hommes
se convertit au langage descriptif proposé par la science, c’est sans
doute à cause de sa rigueur logique
et de l’objectivité
de ses
méthodes. Les
mathématiques, qui structurent une grande
part de la
pensée scientifique fournissent
des schémas d’organisation
applicables
au prix d’une certaine abstraction, mais permettant des avancées
importantes dans la compréhension de la réalité et dans les capacités
prédictives des sciences. Ce sont ces capacités
prédictives, confirmées
au plus haut point dans bien des réalisations
de la technique, qui ont
fait le crédit actuel de la science.
La
caution scientifique est ainsi couramment revendiquée lorsqu'il s'agit
d'anticiper l'avenir. Les études d'ingénierie en construction, le
résumé pour décideurs du GIEC ne sont pas autre chose. Les prévisions
des économistes sont peut-être plus douteuses. Le prestige ou le
crédit de la science prête aussi à un certain parasitage, certaines
pseudo-sciences imitant le langage scientifique et notamment les
mathématiques pour usurper leur légitimité. Ce processus inévitable est
en quelque sorte la rançon du succès. Pour y échapper, il faut un
certain discernement, d'autant plus qu'il est arrivé dans l'histoire
des sciences que certaines spéculations assimilables aux
pseudo-sciences ont pu parfois être à l'origine de théories reconnues
par la suite. Dans un autre domaine,
le rêve ou le cauchemar peuvent
aussi être nourris de science.
L'incontestable popularité de la littérature de science-fiction en est la
preuve.
Think-thimble
http://antoine.li.free.fr
|
|