
 |
||||||
accueil |
billet |
philosophie |
sciences |
culture |
lectures |
liens |
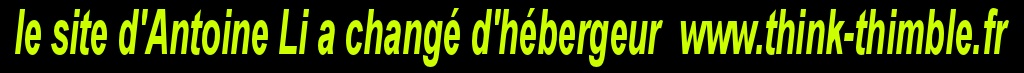 |
|||||
CriseCrise de la biodiversité, crise climatique, crise de l’énergie, crise économique et financière, crise des valeurs. Bien des choses sont déclarées en crise. Nous vivons une époque inquiète, insatisfaite, instable, confrontée à des problèmes généralement réels mais aussi parfois fantasmés. Cependant, même si c’est assez schématique, cette accumulation de crises a un dénominateur commun principal qui est celui de la collision entre la finitude de la planète et l’expansion humaine démographique, marchande et mondiale. Cette collision, lente à l'échelle de l'individu n'en est pas moins rapide, voire brutale lorsqu'on la réfère à l'évolution des civilisations ou à l'histoire de la biosphère. Cette vision synthétique est importante pour prendre clairement conscience des difficultés, hiérarchiser les problèmes et éviter le relativisme. Mais une telle lucidité n’est pas toujours bien vue. On taxe de catastrophisme ceux qui parlent de crise planétaire, les accusant de gonfler les problèmes pour faire peur, une peur qui, chacun le sait, serait mauvaise conseillère. Des crises, dit-on souvent pour se rassurer, il y en a toujours eu, les crises sont passagères, elles sont généralement surmontées. Pour ces tenants du « business as usual » nous ferions mieux d’oublier ces alarmes, de garder une confiance inoxydable ou même de saluer les crises comme un bienfait. Crise, changement et évolutionQu’on parle de la planète, de l’humanité ou de chacun de nous, l’histoire n’est pas un long fleuve tranquille. Même si on voit se succéder des périodes de stabilité, les transitions correspondent plus ou moins à des difficultés. La vie d’un individu est marquée par des épisodes de maladie, par des crises à l’adolescence, vers la quarantaine ou à son départ en retraite. La biosphère a connu de grandes crises (Permien, crétacé-tertiaire, anthropocène) qui correspondent à des changements majeurs dans l’évolution de la vie. L’histoire humaine passe par des périodes de guerre, des crises économiques ou des reculs de la civilisation. La crise est une phase de mutation, une instabilité, elle est associée au mouvement, au changement, à l’évolution.Si la crise peut déboucher sur un mieux être, elle n’est en général pas une période de bonheur. Elle fait des victimes, des dégâts, et selon son issue, on aura plus ou moins tendance à oublier ces aspects négatifs. On a donc un jugement ambivalent sur la crise, car le mal immédiat qu’on souhaite limité et passager porte éventuellement un espoir pour le futur. On n’oubliera pas que certaines crises emportent tout, que des maladies tuent, que des crises de l’histoire ont fait disparaître des civilisations, ni que des catastrophes naturelles laissent derrière elles des déserts pour longtemps. Il faut alors beaucoup de recul et une vision très distanciée pour juger positivement ces épisodes. On retombe sur l’épineuse question du Progrès. La perspective d’un avenir plus stable, plus harmonieux, plus heureux aide à rendre la crise acceptable et incite à préparer l’après crise. On en espère une meilleure issue, et on peut ainsi conserver des pensées plus positives. Mais cette attitude a surtout une vertu psychologique, et la question des échéances de temps est fondamentale. L’espoir d’une issue heureuse n’aide à supporter la crise que si cette issue est vraisemblable et dans un délai pas trop lointain. L’avènement de l’ère tertiaire n’a en rien consolé les dinosaures disparus, et pour en revenir au présent, nous mesurons très mal sur quelles durées se jouera la crise de l’anthropocène amorcée depuis quelques générations. C’est vraisemblablement pour maintenir cet espoir que nous préférons parler de « problèmes » (terme de technocrate) plutôt que de « questions » (terme plus philosophique), car en principe, si les questions peuvent rester sans réponse, les problèmes, pour peu qu’ils soient bien posés finissent par trouver une solution. Comment soigne-t-on les crises ou comment sort-on des crises ?Pour décider comment il convient d’agir en temps de crise, il faut essayer de mesurer les risques d’une issue fatale, et la nécessité d’une intervention. Il faut aussi mesurer quels bénéfices on peut retirer du laisser-faire ou au contraire de soins attentifs. La crise de l’adolescence fait partie du vécu normal de l’humain qui grandit, et il importe juste de l’accompagner en veillant à ce qu’elle aide le jeune à se construire. La crise physiologique déclenchée par un empoisonnement passe par des mesures d’assistance qui peuvent être intenses, en attendant l’évacuation des substances nocives. Ce qui paraît simple dans ces exemples l’est nettement moins lorsqu’on affronte les inévitables difficultés du vieillissement, du grand âge et de l’approche incontournable de la mort.Pour la société, dont le bien-être est complexe à apprécier, les points de vue les plus divers peuvent s’affronter, et l’histoire tire des leçons contradictoires de ces exemples multiples. C’est tout l’art de la politique que de savoir repérer les bonnes questions, faire les bons diagnostics, et à partir de là prendre des décisions judicieuses. Lorsque la crise est planétaire, le diagnostic est inévitablement complexe et il devient encore plus difficile de départager entre le bien-être des hommes actuels ou futurs et le bonheur général de la planète. En particulier, on ne sait pas bien comment les évaluer, ni s’il faut les opposer ou les confondre. Au delà, même si la société parvient à une prise de conscience, il faut encore trouver un accord sur les stratégies d’action. Malgré cette difficulté, on peut raisonnablement penser que notre bonheur passe par la bonne santé de la biosphère, et que la prévention est largement préférable à l’attente passive. Même si cet opinion n’est pas partagée par tous, la majorité des experts considère aujourd’hui que toute mesure visant à anticiper les difficultés devrait par principe être salutaire au niveau collectif. La décision collective en temps de criseLorsqu’elle est touche la société, chaque crise donne le spectacle d’une opposition entre prophètes de malheur, alarmistes rationnels, mais aussi négationnistes et autruches. Plus tard, l’issue de la crise arbitrera peut-être entre les prudents et les inconscients, les frileux et les audacieux, les prévoyants et les opportunistes, les victimes, les charognards et les reconstructeurs. Après chaque crise, on promet de revenir à moins d’inconscience et plus de prévention, même si cela n’est pas toujours suivi d’effets concrets. Mais avant que le temps ne passe et décide des issues, la collectivité est dans les plus grandes difficultés pour opérer des arbitrages.La situation où nous sommes actuellement est typique de ces incertitudes. Les mots les plus familiers (bonheur, progrès, réforme, naturel, écologique, …) deviennent glissants, sont récupérés par tous les partis, et il devient difficile d’éclairer l’opinion dans cette cacophonie. Savoir trouver les bonnes sources d’information, apprécier correctement les enjeux, s’appuyer sur les leçons du passé, trouver les bons leviers pour agir, toutes ces questions sont indécises et mettent parfois du temps à s’éclaircir. Depuis une quarantaine d’années qu’est paru le rapport du Club de Rome pointant explicitement la nature de la crise actuelle, on a vu l’opinion et le monde politique débattre des enjeux, leur tourner résolument le dos, puis y revenir, non sans hésitations et contradictions. Et pourtant, un retour sur ces prévisions montre encore aujourd’hui leur grande pertinence, contrairement à ce qui avait été dit un peu rapidement au vu d’une évolution passagère de la conjoncture. Heureusement que depuis cette époque, certains se sont obstinés contre vents et marées à travailler « dans le bon sens », produisant des exemples concrets et accumulant une expérience aujourd’hui si utiles. On voit bien l’extrême difficulté de la prise de conscience collective et de sa traduction dans les faits, et fait parfois douter de l’émergence d’une sagesse collective. Dans son petit livre joliment intitulé Le Temps des Crises, Michel Serres rappelle que la crise a la même étymologie que critique et critère, et qu’une crise, c’est entre autres quelque chose qui appelle une décision, qui nécessite de trancher. Il ramène aussi plusieurs problèmes de notre époque au fait que la population devenant en majorité urbaine, les bons connaisseurs de la nature, qui seraient le mieux à même de penser la remise en cause, perdent en influence. Pour lui, sortir par le haut de la crise écologique impose de « ré-enraciner » l’humanité « hors-sol », et passe par une refondation de notre sagesse ancrée dans les valeurs naturelles. Think-thimble http://antoine.li.free.fr |
  |
||||
Mots associésEvolution ProgrèsSlip - stick Croissance Dette Economie Planète Nature - vie Ecologie Ecologiste Peur, précaution Confiance, optimisme Tous dans le même bateau? Penser, agir au XXIe siècle vers liste alphabétique |
|||||
Liste des mots clésUnivers Planète Nature - vie Emergence EvolutionHomme Pensée Volonté et liberté Pensée, volonté collectives Individu - société Le bien, le mal, la morale Buts, finalités Bonheur Sagesse Harmonie, beauté Parfait Ennui Rationalité, Logique Science Complexité Analogie Métaphysique Dieu, religion Hasard Futur Progrès Modernité Nomadisme Utopie Extraterrestres Développement Progrès technique Energie Force, puissance Economie Affaires Intérêt Marché, marchandise Valeur Croissance Dette Compétition Performance Décomplexé Hédonisme Récupération Démocratisation Populisme Domestication, troupeau Aliénation Peur, précaution Confiance, optimisme Pragmatisme Opportunité Limites, illimité Barrières, cloisons Echelles, mesure Horizons Mécanique Vitesse, lenteur Frottements, freins Slip - stick Effet transistor Météorologie Immobilisme, changement Banc de poissons Mayonnaise Surimi Préfixes Suffixes Oxymores Durable Renouvelable Ecologie Ecologiste Empreinte écologique Décroissance Cycle Diversité Artifice Racines Jardin Produit Usine à gaz Déchets Sobriété Santé Drogue, addiction Obésité Crise Vérité, doute, certitude Tous dans le même bateau? Penser, agir au XXIe siècle |
|||||
auteur
|
|
haut de la page
|
retour à l'accueil
|
billets anciens
|
ancien site
|